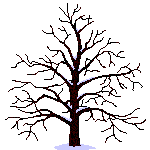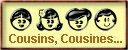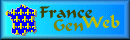La sécularisation de l'état civil

Pendant plusieurs siècles, l’enregistrement des grands évènements de la vie ont été recensés par l’église catholique. Mais il s’agissait des évènements religieux (baptêmes, mariages et sépultures) ne concernant que les seuls catholiques.

En 1792, la Révolution française fait tomber le monopole. Le 20 septembre est votée la sécularisation de l'état civil (sécularisation : rendre à la vie laïque les choses consacrées à la vie ecclésiastique - Larousse) qui consiste à confier la tenue des registres aux municipalités au lieu des paroisses. Les registres d’état civils sont nés et succèdent aux registres paroissiaux. Ces derniers peuvent néanmoins continuer à être tenus, mais cela ne relève plus que des choix personnels et des croyances de chacun.
Dès lors, ce sont désormais les actes de naissance, de mariage, de décès qui sont recensés et sur des registres spécifiques pour les municipalités importantes (plus de 1500 habitants). Les curés clôturent les registres courants et les remettent aux municipalités qui en poursuivent la rédaction dès l’année 1792 concernée. Les registres continuent à être tenus en double, l'un restant en mairie, l'autre déposé aux archives du département où ont été transférés les doubles conservés au greffe.
- C’est à cette époque qu'apparaissent certaines des lois qui régissent encore notre société actuelle :
- le mariage religieux n'est plus obligatoire mais ne peut avoir lieu qu'après le mariage civil,
- les déclarations de naissance doivent être effectuées dans les 3 jours suivant la naissance,
- parrain et marraine doivent élever l’enfant en cas de disparition de ses parents (il s’agit en fait d’un article d'une loi votée par la Convention, jamais abrogée, créant le baptême civil qui place l’enfant sous la protection légale de la République).
A noter que pour lutter contre la persistance du mariage religieux, une loi de 1798 a tenté de donner au mariage civil une plus grande solennité en transférant la célébration des mariages dans les chefs-lieu de canton. Ce système a été réformé par Bonaparte en 1800 par le retour de la célébration des mariages dans les communes et l’ouverture immédiate de nouveaux registres. Ainsi, du 22 septembre 1798 au 10 mai 1800, des registres de mariages sont apparus au niveau des cantons, soit par canton, soit par commune. Ces registres peuvent se trouver aujourd'hui regroupés au chef-lieu du canton ou répartis dans les communes concernées.
Des actes de divorces ont existé un temps, enregistrés avec les mariages puis dans un registre dédié avant de disparaître suite à l'abandon du recensement des divorces. Le divorce lui-même, après avoir brièvement disparu est définitivement rétabli en 1884, considérant que le mariage - étant devenu un contrat civil - n’est plus un serment.
Depuis le XIXe siècle la législation a rendu plus précise la rédaction des actes : numéro d'ordre pour les recherches, date du contrat avec nom et résidence du notaire pour les mariages, date et lieu du mariage ou du divorce pour les naissances, date et lieu de décès, changement d’état civil (orthographe, légitimation, adoption), tenues des tables dans l'ordre alphabétique, inscription des femmes à leur nom marital comme de jeune fille.
Depuis le 1er janvier 1927 : les registres des publications de mariages ou bans ne sont plus tenus. Depuis 1959, ils peuvent être détruits. Beaucoup d'entre eux, jugés inutiles, l'ont été, à tort sans doute, car ils facilitaient les recherches de mariages célébrés entre époux originaires de communes différentes, étant publiés dans chacune des deux.
Depuis 1970, les communes de moins de 2000 habitants doivent déposer leurs archives de plus de 100 ans aux archives départementales. Enfin, ce qui a survécu des minutes des notaires, des registres paroissiaux et des comptes-rendus de justice s'y trouve également.
[ Sommaire ]
[ En-tête ]
"Cousins, cousines..." Le site de généalogie de la Famille Granger-Thomas - Copyright © M&MT Granger-Thomas 2001-2014Arbre | Accueil | Génèse | L'Arbre| Célébrités | Curiosités | Histoire | Etat civil | Entraide | GeneaNet
Hist-Géné. | Cousins | Liens | Livre d'Or | Contact | Nouveautés | Plan | Recherche
RGPD
Ce site n'utilise pas de cookies.
Les sites ciblés par les liens proposés assument leur propre politique de confidentialité que nous vous invitons à examiner.